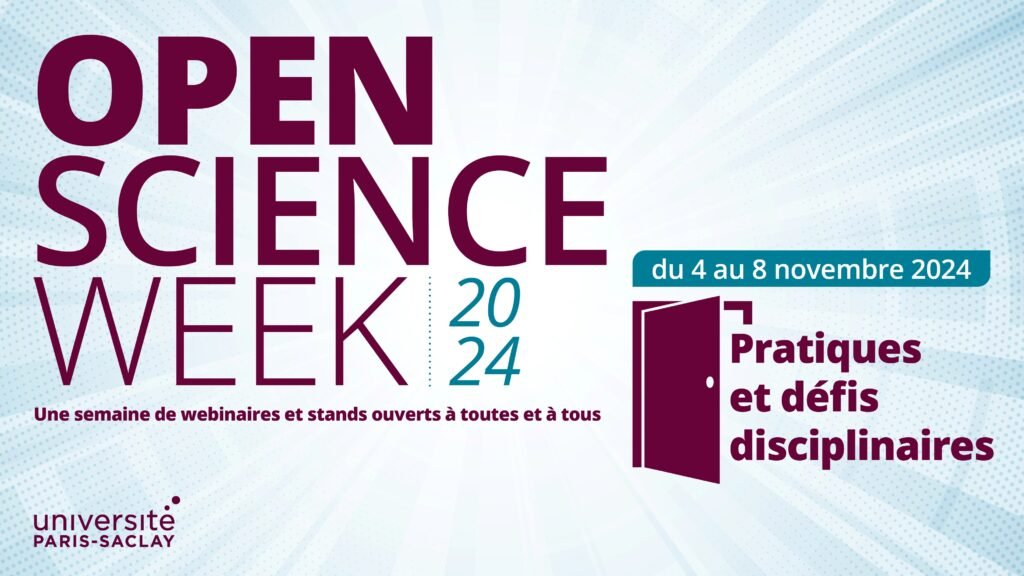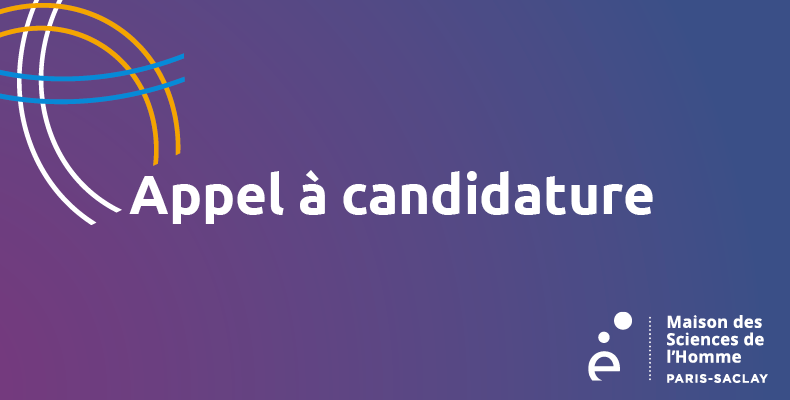nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 20 novembre 2024
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 20 novembre 2024 Lire la suite »
Le mercredi 20 novembre 2024 à 17h30 se déroulera la troisième séance du cycle 2024/2025 de conférences portant sur les nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement – Raréfaction : le prisme du sol
La séance n°3 aura pour thème : l’érosion des sols
Intervenants :
Animation de la séance : Jérôme Fromageau, Président de la SFDE
Lieux : 17h30 en salle Vedel, Faculté Jean Monnet, 54 boulevard Desgranges, Sceaux
Lien visio : ICI
Contact : yasmina.belahcen@universite-paris-saclay.fr
Séance n° 1 inaugurale. Mercredi 2 octobre 2024. Enjeux de la protection du sol
Séance n° 2. Mercredi 16 octobre 2024. Pollution des sols
Séance n° 3. Mercredi 20 novembre 2024. Érosion des sols
Séance n° 4. Mercredi 29 janvier 2025. Artificialisation des sols
Séance n° 5 conclusive. Mercredi 12 février 2025. Accaparement des sols
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 20 novembre 2024 Lire la suite »
Présentation :
L’Université Paris-Saclay organise chaque année l’Open Science Month. Un événement d’envergure internationale visant à promouvoir l’accès aux résultats de la recherche.
Cette année, du 4 au 8 novembre 2024, l’événement devient l’Open Science Week et se fera principalement en ligne. L’occasion de revenir sur les bonnes pratiques et les défis disciplinaires dans les domaines tels que les sciences humaines et sociales, géosciences/environnement, les sciences du vivant, la santé…
L’Open Access Week est un événement international visant à promouvoir l’accès aux résultats de la recherche. L’Université Paris-Saclay s’inscrit dans cette dynamique .
L’évènement, proposé principalement en ligne, sera l’occasion de revenir sur les bonnes pratiques et les défis disciplinaires dans les domaines tels que les sciences humaines et sociales, géosciences/environnement, les sciences du vivant, la santé…
Public cible : enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants, étudiants en masters.
Le programme inclut :
• Des conférences et webinaires interactifs sur les outils et ressources de la science ouverte
• Des projets innovants comme le catalogue de données Agrilogue ou le code de simulation Smilei
• Des discussions sur les aspects juridiques et les pratiques éthiques liés à la gestion et la publication des données de recherche
• Des tables rondes multidisciplinaires, comme celle sur la science ouverte en sciences du sport
• Et bien d’autres initiatives pour encourager la collaboration scientifique à travers le monde
Plus de détails : ICI
Lieux :
L’événement se déroulera principalement en ligne, avec quelques sessions en présentiel à l’Université Paris-Saclay.
Inscriptions : ici
Open Science Week du 4 au 8 novembre 2024 Lire la suite »
Le vendredi 1 1 octobre 2024 de 16h à 19h
Ce carnet de recherche traite des sources, des acteurs et des espaces des circulations culturelles dans le cadre d’une histoire connectée de l’espace transatlantique. Mettant en réseau les travaux scientifiques de chercheurs internationaux, il est articulé à la plateforme numérique Transatlantic Cultures – Histoires culturelles de l’espace atlantique, XVIIIe-XXIe siècles.
Cette séance est mutualisée avec le séminaire SigloXX- SéculoXX (IHEAL)
Lieu : à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris, de 16 h – 19 h, en salle Benjamin
Plus d’info : ICI
Intervenant.e.s :
Modération : Olivier Compagnon (Professeur d’histoire contemporaine, Université Sorbonne Nouvelle, IHEAL, CREDA UMR 7227, IUF)
Retrouvez l’intégralité du programme Transatlantic Cultures ICI
Séminaire Tracs Transatlantic Cultures 11 octobre 2024 Lire la suite »
Le mercredi 9 octobre 2024 de 8h30 à 18h15 se déroulera à l’ENS Paris-Saclay le workshop issue de l’invitation chercheur de Lionel Page (Queensland University, Australia).
Lieux : amphi 1b26, ENS Paris-Saclay, 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette
Inscription gratuite mais obligatoire : ici
contacts:
solange.soubrier@ens-paris-saclay.fr (CEPS)
Local Organizer: francois.pannequin@ens-paris-saclay.fr
8:30 – 9:00: Welcoming participants (room 1B26, ENS Paris-Saclay)
9:00 – 10:30: Happiness explained: Information and utility, Lionel Page (Queensland University, Australia) – room 1B26
10:30 – 11:00: Coffee Break
11:00 – 12:30: Overconfidence: Strategic formation of self-beliefs, Lionel Page (Queensland University, Australia) – room 1B26
12:30 – 13:30: Lunch
In the afternoon, presentations continue in room 1E26
13:30 – 15:00: The ecological and psychological origins of individual preferences, Nicolas Baumard (Ecole Normale Supérieure, PSL University) – room 1 E26
15:00-16:30: Time-discounting et risk taking, Mélusine Boon-Falleur (Ecole Normale Supérieure, PSL University) – room 1E26
16:30 – 16:45: Coffee Break
16:45 – 18:15: “The revival of information integration theory to account for inter-individual variability in decision making », Michel-Ange Amorim (CIAMS, Université Paris-Saclay) – room 1E26
Workshop in Behavioral Economics le 9 octobre 2024 Lire la suite »
Jeudi 5 décembre 2024 – de 14h00 à 16h30 – avec Marc ALOCHET, Ecole Polytechnique.
Le séminaire du Gerpisa est un espace privilégié de rencontre entre l’université et les acteurs politiques et industriels autour des débats qui animent l’avenir de l’industrie automobile.
Le séminaire accueille des chercheurs de diverses disciplines (économie, sociologie, gestion, etc.) à la pointe de leur domaine (électrification, véhicule autonome, avenir du travail, nouvelles mobilités, etc.) afin de présenter leur recherche et nourrir les réflexions sur l’une des principales branches de l’économie française en termes d’emplois et de valeur ajoutée. L’objectif du séminaire est ainsi de répondre aux questions urgentes auxquelles fait face l’industrie automobile. En cela, les séances visent à apporter des éléments de réflexion historique et prospective, ancrés dans des recherches empiriques, pour appréhender les transformations considérables que traversent l’industrie et les usages de l’automobile.
Pour cette troisième séance dédiée au véhicule électrique abordable nous avons invité Marc Alochet (Ecole Polytechnique) pour nous parler du cas chinois.
En moins de 20 ans, en partant de zéro, et malgré des résultats très décevants jusqu’en 2013, l’industrie des NEV (New Energy Vehicle) s’est imposée comme leader en 2021, avec plus de 50 % des ventes mondiales de véhicules électriques rechargeables réalisées en Chine.
Selon Marc Alochet, ceci est le résultat de quatre facteurs principaux, le premier étant la détermination stratégique forte et de longue date du gouvernement chinois à construire une industrie automobile de premier plan au niveau mondial.
Le deuxième facteur est l’implication continue des autorités provinciales et même municipales par le biais de programmes de démonstration nationaux successifs.
Le troisième facteur est la domination écrasante de la chaîne de valeur des batteries, de l’extraction minière au traitement et à la fabrication des cellules et des packs, qui a bénéficié de toutes les leçons tirées de la prise de contrôle de la chaîne de valeur des terres rares depuis les années 1960.
Le quatrième facteur est un cadre réglementaire et financier qui soutient le déploiement d’un système industriel pour l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule électrique, de l’extraction des matériaux au recyclage. Pour y parvenir, deux stratégies complémentaires ont été déployées simultanément : la création de l’industrie du NEV et l’amélioration continue des performances de tous les véhicules, qu’il s’agisse de véhicules à énergie traditionnelle (TEV) ou de NEV.
S’appuyant sur une description détaillée des mécanismes sous-jacents à ces quatre facteurs dans un rapport publié en 2023 (Alochet 2023), Marc Alochet concentrera son analyse sur ce que les cadres réglementaires et financiers de la Chine, tant au niveau national que local, peuvent nous apprendre sur la manière de parvenir à un VE abordable et durable.
Plus d’infos : ici
LIEU : CCFA 2 rue de Presbourg 75008 Paris
La participation est ouverte mais nous vous prions de vous inscrire ou de nous contacter préalablement.
Inscriptions et programme mis à jour (salles, horaires) sur http://gerpisa.org/node/5167
Il aura pour thème : Partout et en tous temps? Les lieux propices au harcèlement sexuel avant #metoo.
Françoise Héritier s’interrogeait quelque temps avant sa mort sur le moment historique que l’Occident vit depuis l’affaire Weinstein, un moment qui semble marquer une rupture de sensibilité sur la question du harcèlement sexuel et qui correspondrait à une libération de la parole des femmes devant les violences qu’elles subissent.
Pour établir la singularité de l’ère post-Weinstein, il apparaît cependant nécessaire de considérer le harcèlement sexuel comme un phénomène historique ayant connu des occurrences antérieures à la post-modernité, une position déjà défendue en 1994 par Carol Bacchi et Jim Jose, qui mettaient en garde contre la tendance à représenter le harcèlement sexuel comme une « découverte » des mouvements féministes actuels (Bacchi & Jose 263). Bacchi et Jose considéraient cette démarche comme « un piège téléologique » pouvant conduire à la négation des expériences des femmes des siècles passés. Cette tendance n’a pas entièrement disparu comme en témoigne la déclaration d’Alain Corbin dans un article de 2017 dans La Croix : « Le mot de harcèlement est très nouveau. Longtemps, la question ne se posait pas car les hommes et les femmes se croisaient peu, du moins dans les villes. Par exemple, jusqu’à la première partie du XIXe siècle, la femme honnête ne sortait pas seule dans la rue, où il n’y avait d’ailleurs pas de trottoir ».
Le projet AVISA vise donc à faire émerger d’autres périodes dans le passé au cours desquelles des femmes et des hommes ont subi, parfois dénoncé des comportements relevant du harcèlement sexuel et éventuellement lutté contre eux, de manière juridique ou symbolique. Sur la base des enseignements apportés par les nombreux travaux sur l’histoire des violences sexuelles, on ne pourra prétendre à une historicisation linéaire du harcèlement sexuel en Occident notamment dans la mesure où, comme pour les violences sexuelles, les sources s’annoncent rares, disparates et inégales selon les lieux et les siècles (D’Cruze 378-379). Cela ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’est pas un fait social chronique constant et omniprésent (Bularzik 119) mais seulement que son histoire ne peut être écrite que de manière fragmentée et qu’elle doit dépasser le tabou scientifique du chiffre noir. Ce n’est pas parce que nous ne parviendrons pas à rendre compte de l’entièreté de la réalité historique en la matière que nous devons continuer de la passer sous silence. Et c’est la raison pour laquelle notre projet s’inscrit dans un premier temps dans l’histoire des représentations qui permet d’ouvrir le chantier de l’historicisation du harcèlement sexuel sur la longue période en mobilisant la littérature, l’histoire, le cinéma, les arts.
Le harcèlement sexuel est ici entendu, hors d’un cadre juridique précis en raison d’une recherche collective sur la longue période et dans plusieurs espaces géographiques, dans un cadre conceptuel qui englobe ses versions française, européenne et anglophone. Il renvoie au fait d’incommoder quelqu’un :
– en tenant de manière répétée des propos à caractère sexuel ou des gestes à caractère sexuel (lorgnades, sifflements, cris, etc…)
– en imposant des contacts physiques non désirés (baisers, attouchements, pincements, etc…) constituant une agression.
– en faisant des avances sexuelles non désirées.
Le harcèlement sexuel peut précéder dans le temps et précède dans la hiérarchie des violences sexuelles la coercition sexuelle ou le viol. Il consiste en des micro-agressions assimilables selon la formule de Mary Bularzik à un « petit viol » puisqu’elles constituent une invasion de la personne par suggestion ou par intimidation en confrontant la victime, de manière plus ou moins frontale, à sa vulnérabilité (Bularzik 118). Le harcèlement sexuel est donc une forme de pression qui vise à déstabiliser une personne pour qu’elle cède et s’abandonne à l’acte sexuel. Il s’agit d’un outil d’emprise mentale qui annihile toute forme possible de consentement et dont l’invisibilité est nourrie par le soupçon récurrent de la fausseté de la résistance féminine.
Il s’agira dans un premier temps de reconstituer le lexique sous lequel ces agissements, marqueurs de la domination masculine, ont été signalés et dénoncés. Notre approche comparatiste, puisqu’elle sera menée par des chercheurs et chercheuses spécialistes de différents espaces géographiques, entend également étudier les spécificités nationales de ces phénomènes et les variantes culturelles notamment dans leurs justifications ou explications. Cela nous conduira parallèlement à nous interroger sur les éventuelles sanctions imposées aux auteurs de ces actes et à leur traitement judiciaire. Enfin, nous projetons de réaliser à partir de nos sources une topographie socio-historique recensant les lieux propices à ce phénomène social.
Bibliographie
Mary Bularzik, « Sexual Harassment at the workplace » in James Green (ed.), Workers’ Struggles, Past and Present: A « Radical America » Reader, Temple University Press, 1983, p. 117-136
Carol Bacchi et Jim Jose, « Historicising Sexual Harassment », Women’s History Review, 3.2, 1994, 263-270.
Alexis Buisson, « Harcèlement sexuel, des ressorts culturels », La Croix, Vendredi 10 novembre 2017, 2-3.
Shani D’Cruze, « Approaching the History of Rape and Sexual Violence : Notes towards Research », Women’s History Review, 1. 3, 377-397.
Lieux : Amphi 1b26 – ENS Paris-Saclay, 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette
Horaires : 9h-18h
Plus d’infos : ici
Colloque AVISA le 17 et 18 octobre 2024 Lire la suite »
Intervenant : Fanny Cottet, Doctorante UMR Géographie-Cités
Présentation scientifique du cycle de conférences :
L’émergence des questions environnementales, telles que la gestion de la biodiversité ou la mise en discussion des différents usages de l’eau, l’appropriation du vivant, et en particulier des gènes végétaux et animaux, interroge les modalités de gestion de ces biens naturels.
La nécessaire transition écologique nécessite une transformation des institutions et sans doute l’émergence de nouvelles formes d’organisations ancrées dans les territoires. Il convient par ailleurs d’aborder la gestion des communs au plus près des acteurs pour en évaluer l’efficacité.
Ce sont ces questions qui sont explorées dans le cadre de ce séminaire. Pour cela, celui-ci s’articule autour de contributions génériques en sciences de gestion, en économie et en droit et des études de cas portant sur des secteurs économiques particuliers ou sur des objets particuliers, comme l’eau ou la génétique.
Date & horaire : jeudi 7 novembre à 14h30
Plus de détails et inscription : ici
Entité d’affectation : Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
La Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay est une structure d’accueil, d’impulsion, de promotion et de diffusion de la recherche en sciences humaines et sociales au sein de l’écosystème de Paris-Saclay.
La MSH Paris-Saclay a vocation à développer des projets de recherche en sciences humaines et sociales autour d’axes de recherches spécifiques liés à son environnement scientifique et à son territoire. Elle a un rôle de fédération de la recherche dans le domaine des SHS et avec les autres sciences du périmètre saclaysien. Concrètement, elle finance, coordonne et soutient les projets scientifiques des 38 laboratoires partenaires du périmètre saclaysien. Ses activités scientifiques prennent également la forme d’encouragement à la valorisation de la recherche et d’accueil de revues scientifiques, d’hébergement de GIS ou toutes autres structures liées à ses axes de recherches thématiques.
L’ingénieur recruté, sera accompagné dans son travail par un référent scientifique, Baptiste Coulmont et placé sous l’autorité de la direction de la MSH Paris-Saclay. Le poste fait partie du pôle plateformes de la MSH. Il aura trois missions principales :
Les plates-formes universitaires de données (PUD) visent à stimuler l’utilisation des données quantitatives en SHS, particulièrement celles mises à disposition par l’IR* PROGEDO (données de la statistique publique, grandes enquêtes, données issues de la recherche).
Centrées sur le développement des compétences, les PUD prolongent l’action de PROGEDO au niveau régional et apportent un soutien direct aux utilisateurs de données d’enquêtes quantitatives par :
La PUD (Plateforme Universitaire de Données) de la MSH Paris -Saclay (UAR 3683) a vocation à être un service de soutien et de promotion de l’analyse quantitative pour les laboratoires qui travaillent dans le domaine des SHS du site saclaysien.
Activités principales
Diplômes et formations
Diplôme : à partir de Bac + 5
Domaine de formation souhaité : sciences sociales quantitatives (démographie, économie, géographie, sociologie, etc.) ou mathématiques appliquées et sciences sociales
Expérience souhaitable : dans un poste similaire 5 ans minimum
Conditions de recrutement
Poste de catégorie A à pourvoir à temps plein, dès que possible.
Date limite de candidature : 19 août 2024
Pour les fonctionnaires, recrutement par voie de mutation ou de détachement.
Pour les contractuels, portabilité du CDI dans la fonction publique ou poste à pourvoir en CDD pour une durée de 1 an (renouvelable).
Rémunération : selon grille AENES, ITRF et charte contractuelle de l’ENS Paris-Saclay en fonction de l’ancienneté acquise dans le secteur public.
Avantages
Un CV complété d’une lettre de motivation doit être adressé à la DRH par courrier électronique à cette adresse: recrutement.drh@ens-paris-saclay.fr
En raison de la fermeture annuelle de l’ENS Paris-Saclay du 26 juillet au 19 août 2024, toutes les candidatures seront traitées lors de la réouverture de l’école.
Le mercredi 16 octobre 2024 à 17h30 se déroulera la deuxième séance du cycle 2024/2025 de conférences portant sur les nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement – Raréfaction : le prisme du sol
La séance n°2 aura pour thème : la pollution des sols
Intervenants :
Animation de la séance : Aude Farinetti, Maitresse de conférences en droit public à l’Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet, IEDP)
Lieux : 17h30 en salle Vedel, Faculté Jean Monnet, 54 boulevard Desgranges, Sceaux
Contact : yasmina.belahcen@universite-paris-saclay.fr
Séance n° 1 inaugurale. Mercredi 2 octobre 2024. Enjeux de la protection du sol
Séance n° 2. Mercredi 16 octobre 2024. Pollution des sols
Séance n° 3. Mercredi 20 novembre 2024. Érosion des sols
Séance n° 4. Mercredi 29 janvier 2025. Artificialisation des sols
Séance n° 5 conclusive. Mercredi 12 février 2025. Accaparement des sols
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 16 octobre 2024 Lire la suite »
Le mercredi 2 octobre 2024 à 17h30 se déroulera la première séance du cycle 2024/2025 de conférences portant sur les nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement – Raréfaction : le prisme du sol
La séance aura pour thème : les enjeux de la protection du sol.
Intervenants :
Animation de la séance : Raphaël Brett, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet, IEDP)
Lieux : 17h30 en salle Vedel, Faculté Jean Monnet, 54 boulevard Desgranges, Sceaux
Inscription obligatoire : yasmina.belahcen@universite-paris-saclay.fr
Séance n° 1 inaugurale. Mercredi 2 octobre 2024. Enjeux de la protection du sol
Séance n° 2. Mercredi 16 octobre 2024. Pollution des sols
Séance n° 3. Mercredi 20 novembre 2024. Érosion des sols
Séance n° 4. Mercredi 29 janvier 2025. Artificialisation des sols
Séance n° 5 conclusive. Mercredi 12 février 2025. Accaparement des sols
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 2 octobre 2024 Lire la suite »