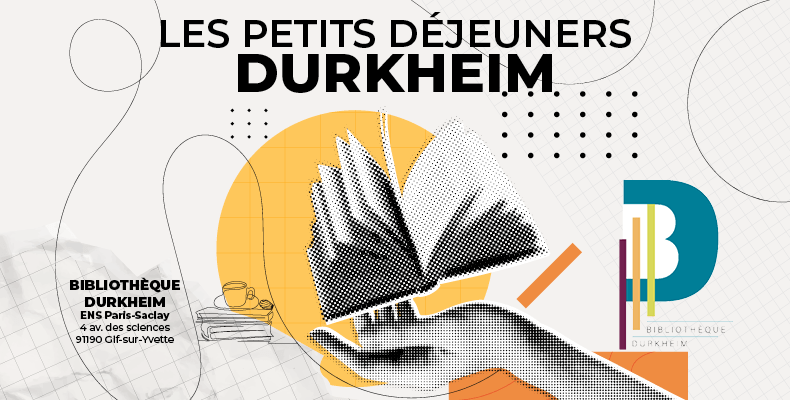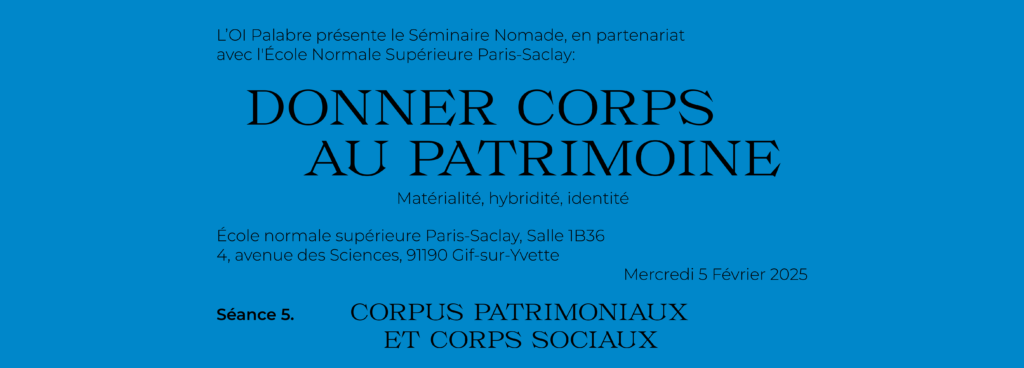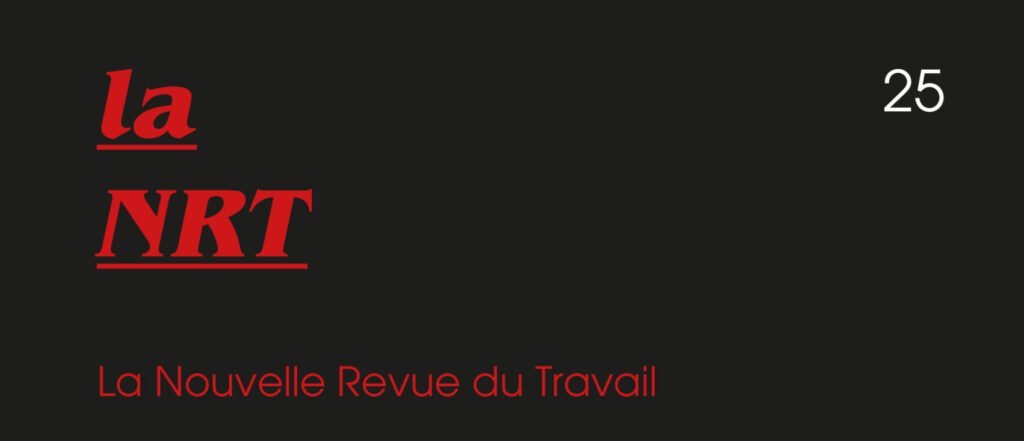nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 29 janvier 2025
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 29 janvier 2025 Lire la suite »
Le mercredi 29 janvier 2025, de 17h30 -19h30, se déroulera la deuxième séance du cycle 2024/2025 de conférences portant sur les nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement – Raréfaction : le prisme du sol
La séance n°4 aura pour thème : l’artificialisation des sols
Avec :
Animation de la séance : Laurent Fonbaustier, Professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet, IEDP)
Lien pour suivre en distanciel : ici
Lieu : Faculté Jean Monnet, 54 BD. Desgranges, 92330 Sceaux. Salle Vedel
nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement le 29 janvier 2025 Lire la suite »
La MSH Paris-Saclay, les laboratoires CEPS, IDHES et ISP de l’ENS Paris Saclay vous invitent à une nouvelle saison des Petits Déjeuners Durkheim.
Autour d’un café à la bibliothèque Durkheim, chercheurs, enseignants, étudiants et tout public intéressé sont conviés à débattre suite à la présentation d’ouvrages issus de travaux en Sciences Humaines et Sociales.
Pour information : Les doctorants venus assister en présentiel aux présentations peuvent créditer des heures de formations dans le cadre de l’École doctorale. L’attestation est à demander à l’adresse suivante : elsa.bansard@ens-paris-saclay.fr et à déposer ensuite sur l’ADUM.
Deux ouvrages de chroniques seront ici l’objet des échanges :
Baptiste Coulmont et Pierre Mercklé, Pourquoi les top-modèles ne sourient pas, Chroniques sociologiques.
Frédéric Lebaron Savoir et agir. Chroniques de conjoncture (2007-2020),
Date – horaire : jeudi 19 décembre 2024, de 10h à 11h30.
Lieux : la bibliothèque Durkheim est située au 3e étage, Bât.sud-ouest au sein de l’ENS, 4 avenue des Sciences 91190 – Gif-sur-Yvette
En partenariat avec les laboratoires CEPS, IDHES et ISP de l’ENS Paris Saclay .
Un jeudi par mois, de 10h à 11h30, voici le programme que nous vous proposons :
Les petits déjeuners Durkheim le 19 décembre 2024 Lire la suite »
Cette cinquième édition du séminaire explorera les liens entre patrimoine et groupes sociaux, en analysant leurs logiques communes et leurs interdépendances. Nous interrogerons comment un corps social – défini comme un ensemble d’individus partageant des caractéristiques ou un concept commun – peut dialoguer avec un corpus patrimonial ou littéraire, constitué de documents ou d’objets réunis selon des critères de cohérence. En explorant la tension entre le tout et les parties ainsi que les interactions réciproques entre corps social et corpus patrimonial, ce séminaire adoptera une approche interdisciplinaire, combinant perspectives inductives et déductives. Nous chercherons à approfondir la compréhension des processus de catégorisation, de conceptualisation et de représentation des faits sociaux et patrimoniaux.
Nous recevrons Nicolas Perreaux, chargé de recherche au CNRS (LaMOP, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), qui travaille sur les grands corpus de données et interroge leur représentativité au regard des structures sociales de l’Europe médiévale, et ouvrira la réflexion autour de son travail Julien Randon-Furling, mathématicien, professeur à l’ENS Paris-Saclay (Centre Borelli). Nous aurons également le plaisir d’écouter Marion Bertin, chercheuse post-doctorante en anthropologie (Université catholique de Louvain), à propos du patrimoine kanak comme « corpus dispersé » et, comme répondante, Ariane Théveniaud, restauratrice, docteure en sciences du patrimoine et post-doctorante (FSP). Pierre-Olivier Dittmar, historien médiéviste, MCF à l’EHESS (GAHOM), interviendra, lui, autour des plafonds peints médiévaux et de la question de la « socialisation » d’un nouveau corpus d’images. Il aura comme répondante Clara Obadia, doctorante en droit sur le patrimoine culturel (ENS-Saclay, ISP).
Inscriptions avant le 25 janvier 2025
Contact : oi.palabre@universite-paris-saclay.fr
Accessibilité :
Depuis Paris, vous pouvez rejoindre l’ENS Paris-Saclay en transports en commun :
Le numéro 25 de La Nouvelle revue du Travail , revue accompagnée par la MSH Paris-Saclay, vient de paraître !
Le dossier de cette livraison de la Nouvelle Revue du Travail porte sur l’individualisation de la formation professionnelle continue en s’interrogeant sur l’éventuel effacement des droits collectifs. En effet, celle-ci a été soumise à un intense réformisme social sous les différents gouvernements depuis trois décennies. Les auteur·es constatent le lent abandon du modèle universaliste au profit de la responsabilisation individuelle des salarié·es dans la gestion de leur carrière. Les articles interrogent ce processus de reconfiguration des pratiques et des usages, de la formation, que ce soit par ceux et celles qui la pensent, la mettent en œuvre ou celles et ceux qui y recourent encore… ou qui l’ont abandonnée.
La première contribution donne la parole à Françoise Laot, sociohistorienne de la formation des adultes qui s’exclame « C’est dangereux, la formation ! » Elle montre comment la formation continue a été pensée et conçue essentiellement par et pour des hommes souvent déjà qualifiés et travaillant dans des grandes entreprises. Parallèlement, elle souligne le rejet, dès les années 1970, des alternatives à l’individualisation de la formation professionnelle continue, aujourd’hui au cœur de la plupart programmes de celle-ci. Le second article s’intéresse aux coachs qui individualisent le « mal au travail », en particulier chez des salarié·es diplômé·es et professionnellement insatisfait·es de leur condition présente, pour trouver le « job de leur rêve ». L’analyse des discours des coachs montre une tendance à l’individualisation et à la dépolitisation des rapports au travail, là où les salariés sont incités à l’exit individuel plutôt qu’à la voice collective. L’article suivant traite de la reprise d’études à l’universitéqui reste une pratique marginale. Il explicite les paradoxes et les tensions d’échelles et d’intérêts qui accompagnent l’individualisation de la formation, entre impératifs collectifs, économiques et sociaux, ressources et émancipation individuelle. Le dernier article de ce Corpus nous fait découvrir les raisons du non-recours à la formation continue en entreprise qui concerne une part non négligeable de la population. L’auteur identifie une variété de profils, contrastés et hétérogènes de celle-ci en étudiant leurs rapports à la formation. Il y montre l’existence d’une « non-demande » de formation qui caractérise certains profils.
Dans la Controverse, la revue a sollicité trois spécialistes de la formation professionnelle continue pour débattre de son individualisation, du recul des négociations collectives et de l’avenir du système de formation. Si des divergences apparaissent dans le débat, les participants conviennent que cette individualisation tient largement à une instrumentalisation par l’emploi ou par l’économie et d’un recul des droits collectifs. Face à la possible ou supposée liberté de choix des individus pour être acteurs de leur parcours professionnel, les contributions font part de différentes manières des capacités individualisées à s’émanciper socialement vers des changements professionnels. Enfin, si l’individualisation de la formation peut contribuer à ajuster les formations aux souhaits exprimés par les individus, l’organisation et le contenu de celles-ci sont bien souvent fortement prescrites ce qui nuit à leur efficacité.
Champs et contrechamps s’est intéressé au Travail vu par la bande dessinée à partir d’une publication bien particulière : le no 9 de la série « Toute la philo en BD ». Laquelle est réalisée par une professeure de philo (scénariste) et par une dessinatrice interrogées par la NRT. Les deux entretiens croisés dissèquent le processus de fabrication, les modalités de travail collaboratif ou de partage des tâches et l’intensité de la coopération pour mettre en image des concepts philosophiques ou la pensée d’auteur·es, souvent perçue comme ardue. Sans omettre les conditions de travail et de rémunération d’une BD dans une collection parascolaire où il s’agit, difficulté inédite, de conduire les lecteurs vers une appropriation différente et complémentaire des concepts philosophiques.
Matériaux et Méthodes propose un genre inédit : les réflexions d’un poète face à une sociologue qui l’interroge sur sa production. En effet, chacun·e possède ses règles, ses repères, ses méthodes mais surtout diverge ou pourrait diverger quant à ses fins. L’incertitude, que la poésie immisce jusqu’au cœur du mot, tranche avec la précision à laquelle aspire en principe la sociologie. Le poète auteur de deux recueils parus dans une grande maison d’édition possède quelques affinités avec la sociologie qu’il lit de temps à autre. Comment faire vivre les deux pratiques chez le même être ? Les réponses du poète montrent la genèse en actes de ses productions, elle-même réinscrite dans sa trajectoire professionnelle
Enfin, ce numéro de la NRT rassemble 23 recensions et notes de lecture plus ou moins critiques qui donnent envie de découvrir des ouvrages récents qui, quelquefois, échappent aux lecteurs, même vigilants…
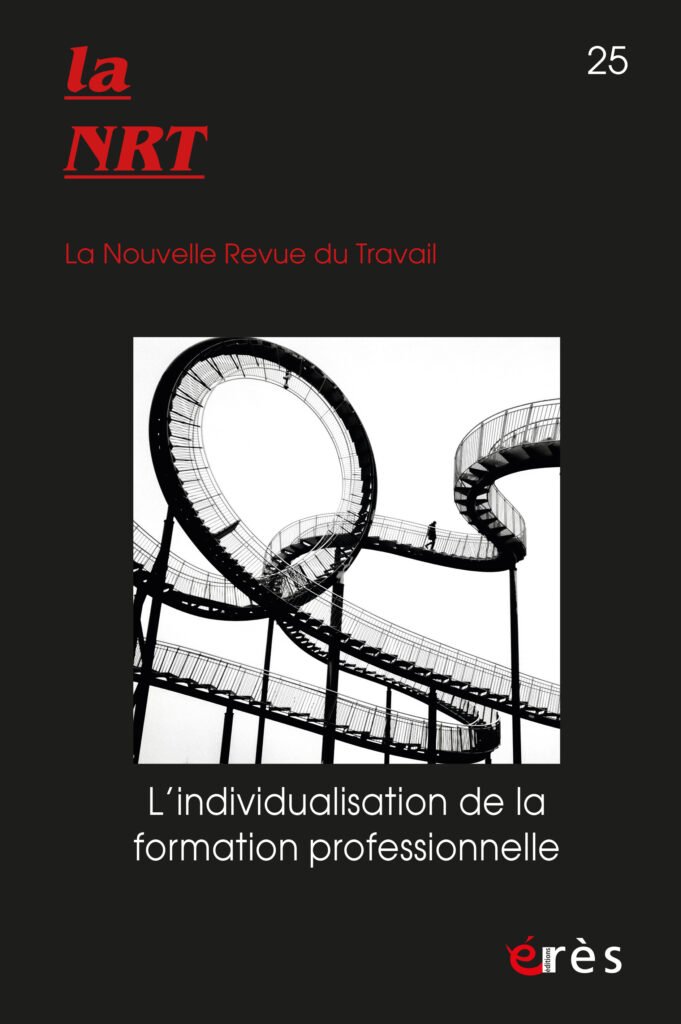
Ce numéro est disponible en version numérique (en accès ouvert immédiat) sur le journal openedition.
La question de médiations des savoirs qu’ils soient scientifiques ou technologiques traverse les pratiques sportives notamment lorsqu’on s’intéresse à la transmission des techniques qui les alimentent. Parler de médiation revient ici à « se demander dans quelle mesure les savoirs sont constitutifs de culture – au sens anthropologique de ce qui permet de partager et d’interpréter des expériences communes » (Lehmans et Condette, 2022) en interrogeant la structuration de la communication, en décrivant les contenus informationnels et les savoirs en direction d’un public apprenants.
Dans le monde sportif, les savoirs culturellement situés qui génèrent des expériences partagées sont constitués de techniques. Nous considérons ici que « la technique est l’ensemble des procédés qui se lèguent de génération en génération, se diffusent par la transmission orale, par l’apprentissage, par l’enseignement, et dont l’utilisation assure l’efficacité de l’action » (Combarnous, 1984, p. 31). Dès lors faire médiation consiste à créer les conditions d’une transmission des gestes techniques mais encore faut-il que les pratiquants soient en mesure de se les approprier. Pour les intervenants du monde sportif, cette question de la transmission ou de l’appropriation des techniques sportives se réalise en tenant compte d’une approche de plus en plus scientificisée du développement du sportif (développement des filières énergétiques, travail sur les éléments biomécaniques du geste sportif, accompagnement psychologique de l’engagement sportif, analyse de la production de la performance). Dans cette logique, l’image sportive déborde le simple cadre de la médiatisation pour être utile à la transformation du sportif lui-même. La mobilisation de l’image peut s’envisager dans des perspectives diverses, interrogeant de fait la compétence professionnelle du joueur, de l’entraineur mais aussi plus largement la communauté sportive et plus largement encore le téléspectateur. C’est dans cette perspective élargie que nous nous interrogerons selon différents angles d’approche l’image comme vecteur de diffusion des savoirs techniques en sport.
Bibliographie :
Combarnous, M. (1984). Les techniques et la technicité. Messidor/Éditions sociales
Lehmans, A. et Condette, S (2022) Médiations des savoirs, regards critiques, approches plurielles. Spirale, revue de recherche en éducation
Lieu : Centre National de rugby – Fédération française de rugby – 3-5, rue Jean de Montaigu 91460 Marcoussis
Date et horaires : le jeudi 21 novembre 2024 de 10h30 à 16h30
Inscription obligatoire avant le 14 novembre : ici
contact : oi.scult@universite-paris-saclay.fr
La MSH Paris-Saclay, les laboratoires CEPS, IDHES et ISP de l’ENS Paris Saclay vous invitent à une nouvelle saison des Petits Déjeuners Durkheim.
Autour d’un café à la bibliothèque Durkheim, chercheurs, enseignants, étudiants et tout public intéressé sont conviés à débattre suite à la présentation d’ouvrages issus de travaux en Sciences Humaines et Sociales.
Pour information : Les doctorants venus assister en présentiel aux présentations peuvent créditer des heures de formations dans le cadre de l’École doctorale. L’attestation est à demander à l’adresse suivante : elsa.bansard@ens-paris-saclay.fr et à déposer ensuite sur l’ADUM.
Christian Bessy Expropriation by law, Février 2024, Editeur : Edward Elgar Publishing, p204, ISBN: 978 1 03532 614 3
Résumé : Placing himself at the crossroads of economics, law, and sociology, Christian Bessy investigates the contemporary transformation of intellectual property rights (IPR) with the emergence of new conventions for their valuation. He demonstrates how entities previously considered inappropriate have now become the object of property rights by means of a creeping legal codification and generate inequalities.
Discutant : Thomas Vendryes (CEPS, Université Paris Saclay)
Date – horaire : jeudi 21 novembre 2024, de 10h à 11h30.
Lieux : la bibliothèque Durkheim est située au 3e étage, Bât.sud-ouest au sein de l’ENS, 4 avenue des Sciences 91190 – Gif-sur-Yvette
A distance : https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/97127415350?pwd=lyL53abhL4XF1eS0au98RZe4s8eHcl.1
ID de réunion: 971 2741 5350
Code secret: 50511035
En partenariat avec les laboratoires CEPS, IDHES et ISP de l’ENS Paris Saclay .
Un jeudi par mois, de 10h à 11h30, voici le programme que nous vous proposons :
Les petits déjeuners Durkheim le 21 novembre 2024 Lire la suite »
Intervenante : Cécile Renouard, ESSEC Business School & présidente du Campus de la Transition.
Présentation scientifique du cycle de conférences :
L’émergence des questions environnementales, telles que la gestion de la biodiversité ou la mise en discussion des différents usages de l’eau, l’appropriation du vivant, et en particulier des gènes végétaux et animaux, interroge les modalités de gestion de ces biens naturels.
La nécessaire transition écologique nécessite une transformation des institutions et sans doute l’émergence de nouvelles formes d’organisations ancrées dans les territoires. Il convient par ailleurs d’aborder la gestion des communs au plus près des acteurs pour en évaluer l’efficacité.
Ce sont ces questions qui sont explorées dans le cadre de ce séminaire. Pour cela, celui-ci s’articule autour de contributions génériques en sciences de gestion, en économie et en droit et des études de cas portant sur des secteurs économiques particuliers ou sur des objets particuliers, comme l’eau ou la génétique.
Date & horaire : mardi 10 décembre à 14h00-16h00
Plus de détails et inscription : ici
Intervenant : Olivier Petit est Maître de conférences en économie à l’Université d’Artois et chercheur au Clersé (CNRS-Université de Lille)
Présentation scientifique du cycle de conférences :
L’émergence des questions environnementales, telles que la gestion de la biodiversité ou la mise en discussion des différents usages de l’eau, l’appropriation du vivant, et en particulier des gènes végétaux et animaux, interroge les modalités de gestion de ces biens naturels.
La nécessaire transition écologique nécessite une transformation des institutions et sans doute l’émergence de nouvelles formes d’organisations ancrées dans les territoires. Il convient par ailleurs d’aborder la gestion des communs au plus près des acteurs pour en évaluer l’efficacité.
Ce sont ces questions qui sont explorées dans le cadre de ce séminaire. Pour cela, celui-ci s’articule autour de contributions génériques en sciences de gestion, en économie et en droit et des études de cas portant sur des secteurs économiques particuliers ou sur des objets particuliers, comme l’eau ou la génétique.
Date & horaire : vendredi 29 novembre à 14h30
Plus de détails et inscription : ici
Prochaine date à retenir :
Le vendredi 22 novembre 2024 se déroulera toute la journée le colloque : sport, santé et environnement.
Plusieurs thèmes seront abordés tout au long de la journée :
Sport et santé
– L’encadrement de la pratique du sport
– De la performance aux excès
– Le matériel sportif
Sport et environnement
– Sport et sobriété énergétique
– Sport et protection animale
inscription gratuite mais obligatoire : ici
Colloque organisé avec le soutien de : DANTE – VIP – GS Droit UPS – MSH UPS
Lieux : Auditorium de la Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines – 45 Boulevard Vauban 78280 GUYANCOURT
Organisateurs du cycle de colloques :
Anaïs Szkopinski, Maître de conférences en droit privé, Laboratoire DANTE, UVSQ
Nathalie Wolff, Maître de conférences en droit public, Laboratoire VIP, Vice-Doyen en charge de la culture, UVS
Eric Azabou, PU-PH en neurophysiologie, Chargé de mission JOP 2024, Inserm 1173, UFR Santé, UVSQ
Sport, santé et environnement le 22 novembre 2024 Lire la suite »
Le vendredi 15 novembre 2024 de 16h à 19h
Intervenants :
Alejandro Gómez (historien, maître de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle / CREDA UMR 7227)
Rafael Pedemonte (historien, maitre de conférences à l’université de Poitiers, CRLA-Archivos / ITEM UMR 8132)
Ce carnet de recherche traite des sources, des acteurs et des espaces des circulations culturelles dans le cadre d’une histoire connectée de l’espace transatlantique. Mettant en réseau les travaux scientifiques de chercheurs internationaux, il est articulé à la plateforme numérique Transatlantic Cultures – Histoires culturelles de l’espace atlantique, XVIIIe-XXIe siècles.
Cette séance est mutualisée avec le séminaire SigloXX- SéculoXX (IHEAL)
Lieu : à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris, de 16 h – 19 h, en salle Peiresc
Plus d’info : ICI
Prochaines dates à retenir :
Retrouvez l’intégralité du programme Transatlantic Cultures ICI
Séminaire Tracs Transatlantic Cultures 15 novembre 2024 Lire la suite »