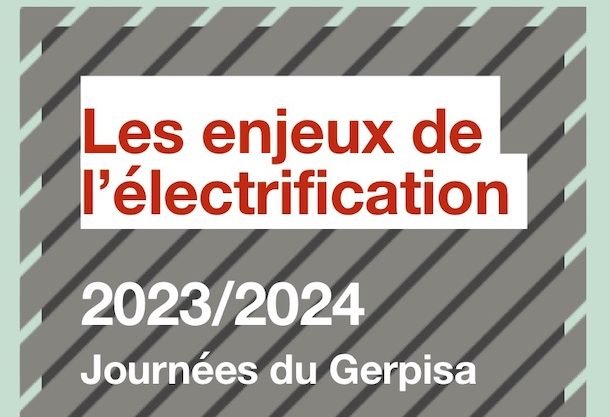Juliette Berny
La 18ème édition des Journées Internationales de Sociologie du Travail du 1er au 3 juillet 2024
PRESENTATION
La 18ème édition des Journées Internationales de Sociologie du Travail se tiendra à Évry les 1er, 2 et 3 juillet 2024.
Elle sera co-organisée par le Centre Pierre Naville (Université d’Évry), le laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS) et la Graduate School Sociologie et Science Politique de l’Université Paris-Saclay.
Après l’édition 2018 des JIST, centrée sur la question des luttes, cinquante ans après le mouvement de mai 1968, et dans la foulée de l’édition 2021, qui interrogeait les brouillages des frontières du travail, l’édition 2024 offre l’occasion de revenir sur les processus d’organisation, de désorganisation et de réorganisation du travail qui sont à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui se sont probablement intensifiés, sous l’effet de différentes crises financières, sanitaires, environnementales.
INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
Les Journées internationales de sociologie du travail se tiendront à l’Université d’Évry
3, rue du Père Jarlan
91000 Évry-Courcouronnes
> Télécharger le plan du campus de l’université
> Lien OpenStreetMap
> Venir en transport en commun ou en voiture
Références GPS : 48°37’28.8″N 2°25’36.7″E
SOIRÉE À LA BELLEVILLOISE
La soirée des JIST 2024 se tiendra à La Bellevilloise à partir de 19h30 :
19-21 Rue Boyer, 75020 Paris
Métro
Métro Gambetta – sortie Orfila (ligne 3)
Métro Ménilmontant (ligne 2)
Accès à La Bellevilloise : Accès en transport en commun
L’entrée se fera sur présentation du badge des JIST.
Retour :
Un bus sera mis à disposition des participants à destination d’Évry, dans la limite des places disponibles (60 places).
Le départ s’effectuera à 23h30 au 94 rue de Ménilmontant 75020 Paris ( à moins d’une minute à pied de la Bellevilloise). Il rejoindra le 23, boulevard François Mitterrand à Évry.
Les inscriptions pour bénéficier du retour en bus sont ouvertes à l’accueil des JIST.
ILLUSTRATIONS
Cette 18ème édition des JIST sera croquée par Tommy Dessine.
Tommy sera présent parmi nous tout au long de cette 18ème édition des JIST pour illustrer en direct les moments forts des plénières, semi-plénières et ateliers.
L’ensemble de ses dessins seront exposés au fil de l’événement dans le hall du bâtiment Maupertuis.
Dessinateur indépendant, Tommy est auteur de plusieurs bandes dessinées dont Géostratégix et Un monde de jeux, co-signées avec le géopolitologue Pascal Boniface. Il travaille également pour la presse et illustre en direct des événements (débats, conférences), dans un esprit « dessin de presse », exercice qu’il pratiquera à l’occasion des JIST !
CALENDRIER
- Dépôt des propositions de communication : 8 janvier 2024 – Report au 19 janvier 2024
Réponse du comité scientifique : 12 février 2024
Inscriptions en ligne : du 7 mars au 14 juin 2024. Les tarifs seront majorés à partir du 18 mai 2024.
Dépôt du texte final de la communication : 15 mai 2024 – Report au 31 mai 2024
Journées Internationales de Sociologie du Travail : du 1er au 3 juillet 2024
CONTACT
Séminaire travailler dans l’interdisciplinarité : retours d’expérience 28 mai 2024
SÉMINAIRE Travailler dans l’interdisciplinarité : retours d’expérience
INFORMATIONS
Le 28 mai 2024 de 9h à 17h30
Le séminaire est organisé par l’Institut de l’Énergie Soutenable, le DIM Pamir et la MSH Paris Saclay. Il donne la parole aux récits d’expérience d’équipes de projet et de représentants de réseaux de recherche. Les projets présentés appartiennent à des champs divers tels que l’environnement, le patrimoine… et intègrent tous une composante en Sciences humaines et sociales.
Lieu : à la Maison de l’Ile-de-France, 9 boulevard Jourdan, 75014 Paris
L’inscription est ouverte et gratuite pour toutes et tous en suivant ce lien. Toute participation peut faire l’objet d’une attestation sur demande à l’adresse suivante : elsa.bansard@ens-paris-saclay.
Plus d’info, l’inscription est gratuite et obligatoire : ICI
Séminaire travailler dans l’interdisciplinarité : retours d’expérience 28 mai 2024 Lire la suite »
Séminaire Gestion et émergence des communs à l’échelle des territoires 29 mai 2024
Séance 3 : Transition vers une nouvelle agriculture dans les pays en voie de développement.
INFORMATIONS
Intervenant : Dr. Matthieu Brun, Directeur scientifique de la FARM & Chercheur associé à Sciences Po Bordeaux – laboratoire du CNRS « Les Afriques dans le monde ».
Présentation scientifique du cycle de conférences :
L’émergence des questions environnementales, telles que la gestion de la biodiversité ou la mise en discussion des différents usages de l’eau, l’appropriation du vivant, et en particulier des gènes végétaux et animaux, interroge les modalités de gestion de ces biens naturels.
La nécessaire transition écologique nécessite une transformation des institutions et sans doute l’émergence de nouvelles formes d’organisations ancrées dans les territoires. Il convient par ailleurs d’aborder la gestion des communs au plus près des acteurs pour en évaluer l’efficacité.
Ce sont ces questions qui sont explorées dans le cadre de ce séminaire. Pour cela, celui-ci s’articule autour de contributions génériques en sciences de gestion, en économie et en droit et des études de cas portant sur des secteurs économiques particuliers ou sur des objets particuliers, comme l’eau ou la génétique.
Date & horaire : mercredi 29 mai à 14h / participation en visio sur Zoom.
Inscriptions : ici
Séminaire Gestion et émergence des communs à l’échelle des territoires 29 mai 2024 Lire la suite »
Séminaire PEPS : Le devenir des œuvres 1 % artistique : construction d’une base de données 11 juin 2024
Atelier « Patrimoine et biens communs »
INFORMATIONS
Le séminaire « Propriété, environnement, patrimoine et société » tiendra sa prochaine séance sur le thème : le devenir des œuvres 1 % artistique : construction d’une base de données
Il sera présenté par Christian Bessy et Pierre-Adrien Ladant | IDHE.S
Date : 11 juin 2024
Lieu : École Normale Supérieure Paris-Saclay
Salle ISP 3K07
4 avenue des Sciences
91 190 Gif-sur-Yvette
Présentation du séminaire
L’idée de ce séminaire est de comparer les formes de propriété en travaillant à partir d’objets complexes tels que le patrimoine, l’environnement et les savoirs.
Les questions traitées seront aussi disparates que : une œuvre d’art dans l’espace public, une invention brevetée, la perspective offerte par un paysage, un site antique menacé par l’ouverture d’un chantier, une opération d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les dates des séminaires s’échelonnent du 10 octobre 2023 au 11 juin 2024.
Le mardi, 14 h – 16 h
Pour connaître l’ensemble du programme
PROGRAMME
9h45-10h : Accueil des participants
Matin (10h00-12h) :
10h : Christian Bessy (IDHE.S-ENS Paris-Saclay) et Noé Wagener (UPEC/ISP),
L’appropriation des œuvres du 1 % artistique. La capture du lion
10h30 : Marie Cornu (ISP-ENS Paris-Saclay),
Le devenir des œuvres 1 % artistique : acteurs, lieux, institutions
1h : Pierre-Adrien Ladant (IDHE.S-ENS Paris-Saclay) et Christian Bessy (IDHE.S-ENS Paris-Saclay),
Le devenir des œuvres du 1% artistique : costruction et exploitation d’une base de données
11h30-12h : discussion avec la participation de Christian Hottin (Institut national du patrimoine)
12h-13h : pause
13h15-14h15 : Initiative ouverte à tout public
Déambulation sur les traces des œuvres du 1% artistique de l’ENS Paris-Saclay
(Rendez-vous à 13h15 devant le « Lion accroupi » de Louis Leygue (1957), parvis principal de l’ENS Paris-Saclay)
Après-midi (14h30-17h) :
14h30 : Sarah Vanuxem (Université de Nice),
La liberté de circulation des animaux sauvages contre celle des êtres humains
15h : Angelo Torre (Università del Piemonte Orientale),
Les Communs comme patrimoine. Une hypothèse de recherche sur les hameaux des campagnes européennes entre Ancien Régime et XIXe siècle
15h30 : Michela Barbot (IDHE.S-ENS Paris-Saclay),
Faire survivre les « pierres parlantes ». Formes de la propriété et sauvegarde des patrimoines soumis à des risques majeurs (Italie centrale, XVIIe-XXe siècle)
16h-16h30 : discussion avec la participation de Christian Hottin (Institut national du patrimoine)
16h30-17h : Conclusions/pistes de travail
Contact pour informations : mbarbot@ens-paris-saclay.fr
Organisation
Michela Barbot | Université Paris 1, IDHES
Christian Bessy | ENS Paris-Saclay, IDHES
Marie Cornu | ENS Paris-Saclay, ISP
Noé Wagener | Université de Créteil et ISP


Journée GERPISA : Politiques pour développer la transition des flotte vers les véhicules électriques : le cas français. 7 juin 2024
Journée Gerpisa : Politiques pour développer la transition des flotte vers les véhicules électriques : le cas français
INFORMATIONS
Vendredi 7 juin 2024 – de 14h à 17h
Le séminaire du Gerpisa est un espace privilégié de rencontre entre l’université et les acteurs politiques et industriels autour des débats qui animent l’avenir de l’industrie automobile.
Le séminaire accueille des chercheurs de diverses disciplines (économie, sociologie, gestion, etc.) à la pointe de leur domaine (électrification, véhicule autonome, avenir du travail, nouvelles mobilités, etc.) afin de présenter leur recherche et nourrir les réflexions sur l’une des principales branches de l’économie française en termes d’emplois et de valeur ajoutée. L’objectif du séminaire est ainsi de répondre aux questions urgentes auxquelles fait face l’industrie automobile. En cela, les séances visent à apporter des éléments de réflexion historique et prospective, ancrés dans des recherches empiriques, pour appréhender les transformations considérables que traversent l’industrie et les usages de l’automobile.
Intervenante :
- Sarah CHADHA (Policy et Engagement Manager EV100 France Climate Group)
Plus d’infos : ici
LIEU : CCFA 2 rue de Presbourg 75008 Paris
Séminaire PéLiAS – Les périodiques comme médiateurs culturels – Séance 2 : les revues d’art 22 mai 2024
Séminaire PéLiAS (périodiques littérature, arts, sciences)
Les périodiques comme médiateurs culturels
Séance 2 : les revues d'art
Informations
Le séminaire PéLiAS (Périodiques, Littérature, Arts et Sciences) se propose d’étudier les périodiques artistiques, littéraires et scientifiques du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle en tant que médiateurs culturels.
Il s’agit d’analyser les périodiques en tant que constructions sociales, matérielles et entrepreneuriales, faisant intervenir de multiples acteurs : écrivains, artistes, typographes, graveurs, imprimeurs, éditeurs, ou lecteurs… et touchant des milieux socioprofessionnels variés (milieux artistiques et littéraires, scientifiques, universitaires, théâtres, galeries, maisons d’édition…).
L’approche adoptée est double : les périodiques sont interrogés en tant que support de
communication appartenant à la culture de l’imprimé et en tant qu’objet culturel pluridisciplinaire.
La notion de médiateur permet également d’insister sur la circulation des idées, des textes, des images et des rédacteurs. Les périodiques sont pensés en terme de « réseau » : un dialogue s’établit entre les différents périodiques, au-delà des catégories traditionnelles qui opposent grande et petite presse, revues et livres, revues artistiques et littéraires et revues scientifiques. Enfin, les périodiques sont étudiés dans leur dimension de vulgarisation, tant au niveau littéraire que scientifique, et dans leur rapport au livre et aux différents publics.
INTERVENANTS :
- Eleni Stavroulaki (Princeton University, Department of Art and Archaeology) La Pensée moderne de la Préhistoire. Le cas des Cahiers d’Art (1926-1969)
Entre 1926 et 1969, Cahiers d’art, la revue et la maison d’édition de Christian Zervos, s’identifie à la défense des courants post-cubistes et à une promotion – au moins dans l’entre-deux-guerres – de l’esthétique rationaliste du purisme et du fonctionnalisme. À côté de ces aspects, Cahiers d’art manifeste une ouverture pour la Préhistoire et les arts extra-occidentaux. C’est ainsi que de récentes recherches ont envisagé la revue, donnant plus de consistance au poids anticlassique de celle-ci. Dans cette intervention je vise à relativiser cette approche longtemps privilégiée, montrant que le récit de Zervos sur les arts pré- et protohistoriques ne s’établit pas sur l’idée d’une rupture évolutive avec l’Antiquité classique, mais au contraire sur celle de temporalités continuistes. Bref, je vais montrer que Zervos a comblé – à la fois sur le plan archéologique et visuel – l’écart entre la préhistoire, la Grèce classique et la production moderne.
- Jean-Michel Galland (docteur en histoire, École des Chartes)
Le « retour à l’antique » en France pendant l’entre-deux-guerres au travers des revues d’art et des livres
Il est généralement question, en littérature ou en art, d’un « retour à l’antique » pendant l’entre-deux-guerres, et d’un « retour à l’antique » appréhendé en tant qu’une composante d’un « retour à l’ordre » qui se serait produit à cette période. Nous questionnons précisément ces deux notions de « retour » dans cet exposé dont l’objet est de présenter un panorama et une analyse, textes et images, des recours, pendant l’entre-deux-guerres, à l’antiquité au travers des revues d’art et des livres illustrés publiés en France à cette période. Une présentation rapide est d’abord faite de l’approche choisie pour mener cette recherche, une approche récemment développée sur la base de la théorie des champs du sociologue Pierre Bourdieu. Nous justifions ensuite le choix des neuf revues d’art sélectionnées pour cette étude, telles que L’Esprit nouveau, Les Cahiers d’art ou Minotaure, puis nous décrivons les différentes bases de données établies dans ce cadre. La base couvrant les revues d’art compile et analyse tous les articles ayant trait à l’antiquité gréco-romaine publiés dans ces revues au cours de la période considérée. Nous rendons compte ensuite des résultats de l’exploitation de ces bases en identifiant, pour chacun des quatre secteurs du champ artistique, les formes de recours à l’antique (univers grec ou latin, orientations esthétiques et idéologiques, etc.) véhiculées par les livres illustrés et par les revues « positionnés » sur la zone considérée, dressant ainsi un panorama à travers le champ de ces recours. Nous mettons alors en évidence la cohérence de ce panorama, en montrant que les formes de recours se répartissent dans la structure en concordance avec les valeurs esthétiques et sociétales qui la sous-tendent. Nous montrons également comment cette répartition spatiale s’inscrit dans l’histoire, récente ou plus lointaine, du champ, corroborant ainsi la « loi du changement » observée pour tous les champs culturels. Nous revenons en conclusion sur les notions de « retour à l’antique » et de « retour à l’ordre » pendant l’entre-deux-guerres et sur les raisons de leur succès critique.
CONTACTS & INSCRIPTIONS
norbert.verdier@u-psud.fr et alexiakalantzis@gmail.com.
L’accès au séminaire se fera sur inscription, avec l’envoi d’un mail à l’adresse :
alexiakalantzis@gmail.com.
Le lien zoom sera envoyé aux participants quelques jours avant.
LIEU : Bibliothèque Jacques Seebacher, Université Paris Cité
Campus des Grands Moulins
5 rue Thomas Mann, 75013 Paris
Bât. A, 2e étage
Organisateurs :
Hélène Védrine (Sorbonne Université, CELLF 19-21)
Norbert Verdier (Paris Saclay, EST-GHDSO)
Alexia Kalantzis (UVSQ, CHCSC)
Comité scientifique :
Evanghelia Stead (UVSQ, CHCSC & IUF)
Hélène Gispert (Paris Saclay, EST-GHDSO)
Viera Rebolledo-Dhuin (UPEC, CRHEC)
Hélène Védrine (Sorbonne Université, CELLF 19-21)
Norbert Verdier (Paris Saclay, EST-GHDSO)
Alexia Kalantzis (UVSQ, CHCSC)
Exposition : Rwanda 1994 – Traces du génocide des Tutsi – du 14 mai au 12 juillet 2024
Résumé
À l’occasion de la trentième commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, le réseau international de recherche RwandaMAP et la Contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, présentent l’exposition itinérante “Rwanda 1994 : traces du génocide des Tutsi” du 14 mai au 12 juillet à la Contemporaine, avec le soutien de l’Institut français du Rwanda, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Maison des sciences de l’homme Paris Saclay.
Construite à partir des collections de la Contemporaine et enrichie d’archives publiques et privées, l’exposition propose de revisiter les principales dimensions du génocide à partir de matériaux inédits ou peu connus, qu’il s’agisse d’archives, de collections de presse, d’objets divers ou de témoignages.
L’exposition met en perspective trente ans de recherches et de débats scientifiues tout en interrogeant la valeur patrimoniale et documentaire des traces du génocide des Tutsi. Elle donne également aux visiteurs l’occasion de questionner les méthodes d’écriture de l’histoire du temps présent. Présentant un ensemble de cent cinquante documents reproduits, parfois inédits, l’exposition trilingue — français, kinyarwanda, anglais — a pour vocation de circuler dans plusieurs villes du Rwanda (Kigali, Huye, Musanze).
Dans le prolongement de l’exposition, le numéro de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps, édité par l’association des amis de la Contemporaine, est consacré au génocide des Tutsi. Coordonné par les commissaires de l’exposition, Rémi Korman et François Robinet, il réunira les contributions de chercheurs francophones et anglophones, notamment rwandais. Un ensemble de rencontres est également programmé pendant la durée de l’exposition, dont l’adaptation d’Une saison de machettes par Dominique Lurcel le 14 mai à la maison de l’étudiant de l’Université Paris Nanterre.
Commissaires de l’exposition : Rémi Korman (Université catholique de l’Ouest) et François Robinet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).
Scénographie, graphisme : Atelier Ping Pong.
Programme des journées du 24 et 25 mai 2024
Vendredi 24 mai
Journée d’étude scientifique : « Enquête sur le génocide des Tutsi : entre archives et terrain »
La Contemporaine, salle n°3
9h30 : accueil
10h00 : mot d’accueil par Xavier Sené (Directeur de la Contemporaine)
Présentation scientifique de la journée par Rémi Korman (CHUS / UCO) et François Robinet (CHCSC / UVSQ)
10h15 – 11h45 : table ronde 1
Faire du terrain : évolutions, pratiques, enjeux de traduction
Modération : Magnifique Neza (Cespra / EHESS) et François Robinet (CHCSC / UVSQ)Violaine Baraduc (Imaf / EHESS) : « L’enquête et son contrechamp. Le binôme chercheur·se-traducteur·rice »Rémi Korman (CHUS / UCO) : « Les mots de l’histoire et de la mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda »Louis Laurent (Cespra / EHESS) : « Parler du génocide des Tutsi à la paroisse Sainte-Famille avec les génocidaires. Entre disponibilité, réinsertion, déni, dissimulation et prudence. »
11h45 – 12h30 : visite de l’exposition « Rwanda 1994. Traces du génocide des Tutsi »
12h30-13h30 : déjeuner
13h30 – 15h15 : table ronde 2
Enquêter sur le génocide des Tutsi : accès, usages, préservation des archives
Modération : Marcel Kabanda (IBUKA) et Florence Rasmont (MMC / ULB)
Karen Taieb (Mémorial de la Shoah) et Luce Mourand (EHESS) : « Les archives du génocide des Tutsis au Mémorial de la Shoah : état des lieux et perspectives ? »
Philibert Gakwenzire (Université du Rwanda) : « Etudier le génocide des Tutsi à partir des archives de la Commune du Rwanda »
Timothée Brunet-Lefèvre (Cespra / EHESS) : « Les procès du génocide des Tutsi en France et ses archives : des sources pour quelle(s) histoire(s) ? »
15h30 – 17h00 : workshop – questions de recherche
Samedi 25 mai
10h30 – la Contemporaine
Rencontre autour des ouvrages Tout les oblige à mourir (CNRS éditions, 2024) de Violaine Baraduc, Le Choc (Galllimard, 2024) et du dossier scientifique « Rwanda 1994 : Archives, mémoires, héritages » de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps (la Contemporaine, 2024).
Une table-ronde modérée par François Robinet en présence de Violaine Baraduc, Samuel Kuhn et Florence Rasmont.
Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Samuel Kuhn, Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le Choc. Rwanda 1994: le génocide des Tutsi, Paris, Gallimard, 2024.
Violaine Baraduc, Tout les oblige à mourir. L’infanticide génocidaire au Rwanda en 1994, Paris, CNRS éditions, 2024.
Rémi Korman, François Robinet (coord.), « Rwanda 1994 : Archives, mémoires, héritages », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2024/1, n°151-152, la Contemporaine, 2024.
11h45 – la Contemporaine
Visite guidée de l’exposition « Rwanda 1994. Traces du génocide des Tutsi » par les commissaires Rémi Korman et François Robinet
13h30 – Auditorium Max Weber – Université Paris-Nanterre
Discussion avec Bruce Clarke, artiste plasticien et photographe britannique d’origine sud-africaine. Modération : Rémi Korman.
Bruce Clarke travaille sur des projets artistiques et mémoriels en relation avec le génocide des Tutsi. Il est notamment le créateur du « Jardin de la mémoire », qui s’étend sur 3 hectares dans le district de Kicukiro, au sud de Kigali. En 2014, Bruce Clarke a peint les « Hommes debout », ces silhouettes d’hommes, de femmes et d’enfants, représentées au Rwanda sur les lieux de commémorations. En 2024, il continue son œuvre avec les « Femmes debout », ainsi qu’une exposition au Camp des milles (Vies d’après).
15h – Auditorium Max Weber – Université Paris-Nanterre
Projection-débat : Rwanda, les collines parlent (Belgique, 2005, 50 min) de Bernard Bellefroid
En présence du réalisateur.
Onze ans après le génocide, ce film accompagne survivants et bourreaux avant et après les premiers procès populaires Gacaca où ils se retrouvent face à face. Il y a Obede, accusé d’avoir tué des enfants et dont la demande de pardon n’est qu’une stratégie cynique pour être libéré. Il y a Gahutu, qui n’a « aucun remords » et qui, face à ses juges, parlent toujours de « serpents » pour parler de ceux qu’on exterminait. Enfin il y a François, obligé de tuer son propre frère pour pouvoir survivre et qui tente aujourd’hui de se réconcilier avec sa belle-sœur. À travers ces trois histoires, le film tisse un portrait d’une société en guerre contre l’idéologie toujours présente du génocide.
Entrée libre
informations pratiques
Lieu :
La Contemporaine
Université Paris Nanterre
184 cours Nicole Dreyfus
92 000 NANTERRE
Accès : Nanterre Université, RER A ou ligne L
Dates et horaires :
- Du 14 mai au 12 juillet 2024
- Du mardi au samedi de 13h00 à 19h00
Entrée libre et gratuite
Séminaire ECOPOLIEN 2 mai 2024
Séminaire ECOPOLIEN
INFORMATIONS
Le 22ème séminaire de l’Atelier d’écologie politique francilien a lieu le 2 mai 2024 de 18h30 à 20h30, en libre accès à la Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale (9 Boulevard Jourdan, 75014 Paris).
Thème – Les entreprises : problème ou solution pour la transition écologique?
Ecopolien est un groupe de travail inter-universitaire (établissements ESR d’Ile de France) et transdisciplinaire (science humaines, sciences de la nature) s’intéressant aux causes des bouleversements écologiques actuelles et aux solutions proposées pour y remédier.
Intervenant.e.s :
- Éléonore Mounoud (Professeure en sciences de gestion, Centrale Supélec)
- Harold Levrel (professeur d’économie, AgroParisTech, CIRED)
- (sous réserve) une actrice du monde de l’entreprise
Ecopolien est un groupe de travail inter-universitaire (établissements ESR d’Ile de France) et transdisciplinaire (science humaines, sciences de la nature) s’intéressant aux causes des bouleversements écologiques actuelles et aux solutions proposées pour y remédier.
INSCRIPTIONS
Ouvert à tou.te.s, inscription gratuite mais obligatoire via ce formulaire : https://ecopolien.org/
Séminaire ECOPOLIEN 2 mai 2024 Lire la suite »
Workshop interdisciplinaire : au-delà de l’H2O 26 avril 2024
Workshop : Au-delà de l'H2O, perspectives économiques, sociales et environnementales sur le bien-être
INFORMATIONS
L’objectif étant de :
- Approfondir la compréhension des défis liés à l’eau et leur impact sur le bien-être global.
- Déceler des axes de recherche novateurs et des problématiques émergentes.
- Favoriser des collaborations interdisciplinaires et internationales.
Contacts et organisation :
- Natalia Zugravu (natalia.zugavu@uvsq.fr)
- Reine Bou Fadel (reine.bou-fadel@universite-paris-saclay.fr)
Événement organisé par la GS Économie & Management en collaboration avec la GS BIOSPHERA, la GS Santé Publique, l’UMI SOURCE, la GS Géosciences, Climat, Environnement, Planètes Recherche, l’Institut de l’Énergie Soutenable de Paris-Saclay et le CentrEau (Québec).
Horaires:
- Vendredi 26 avril 2024 de 8h30 à 17h30
Lieu :
ENS Paris Saclay, Salle 1B36
4 avenue des Sciences
91190 GIF-SUR-YVETTE
Workshop interdisciplinaire : au-delà de l’H2O 26 avril 2024 Lire la suite »